Dans l'accord signé entre la RDC et le Rwanda le 27 juin à Washington, un plan de neutralisation des rebelles hutu FDLR, a été esquissé par Kinshasa et Kigali, sans pour autant répondre aux attentes des victimes du conflit. L'accord ignore également le groupe AFC/M23, dont les discussions se poursuivent à Doha au Qatar.
Une semaine après la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda, les interrogations s'accumulent. Le texte signé à Washington, sous l'égide des États-Unis, prévoit notamment un plan de neutralisation des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), groupe armé hutu accusé par Kigali d'être à l'origine de ces incursions militaires en territoire congolais. Mais la mise en œuvre de ce plan s'annonce délicate, tant sur le plan militaire que politique.
Un calendrier resserré pour un objectif ambitieux
Le document prévoit une opération de neutralisation des FDLR en quatre étapes. D'abord, la création d'un mécanisme conjoint de coordination de la sécurité, censé être opérationnel d'ici au 27 juillet. Ce mécanisme doit permettre la planification conjointe des actions militaires entre les Forces armées de la RDC (FARDC) et les troupes rwandaises.
Suit une phase de préparation de 15 jours destinée à localiser les positions des FDLR et à collecter des renseignements. La troisième étape, opérationnelle, est la plus délicate : pendant trois mois, les forces congolaises sont appelées à intervenir sur le terrain. L'objectif affiché est double : d'un côté, la neutralisation des FDLR ; de l'autre, la levée des mesures dites défensives du Rwanda, notamment les déploiements militaires rwandais.
Mais l'équation est loin d'être simple. Des éléments des FDLR sont disséminés aussi bien dans les zones contrôlées par les FARDC que dans celles tenues par l'AFC/M23. Ces groupes refusent toujours de déposer les armes. Ils avaient demandé l'année passée à la médiation angolaise de faciliter un dialogue direct avec Kigali, sans succès. Le risque de nouveaux affrontements dans les mois à venir est réel.
Des civils peu considérés dans le processus
Autre faiblesse majeure de l'accord : la place réservée aux victimes civiles du conflit. Si les populations déplacées ou réfugiées sont mentionnées, avec un engagement des deux États à garantir leur retour volontaire, sûr et digne, le texte reste silencieux sur toute forme de justice ou de réparation. Aucun mécanisme de vérité, d'indemnisation ou d'accompagnement psychosocial n'est prévu.
Pourtant, plusieurs voix, à commencer par celle du prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, mais aussi du président congolais Félix Tshisekedi, ont régulièrement plaidé pour une prise en charge des victimes dans le cadre du processus de paix. À ce stade, ces revendications ne se traduisent pas encore dans les textes officiels.
L'autre absent de poids dans l'accord de Washington est l'AFC/M23. Ce groupe armé, soutenu par Kigali selon de nombreux rapports onusiens, n'est pas signataire. Les discussions avec le M23 se poursuivent dans un cadre parallèle, celui des négociations de Doha, sous la médiation du Qatar.
À ce jour, ces discussions sont presque au point mort. Un premier projet d'accord avait été présenté, mais une contre-proposition a bloqué les pourparlers. Les deux camps restent irréconciliables sur la méthode : Kinshasa exige un désengagement immédiat du M23, le cantonnement des troupes et le retour de l'autorité de l'État. Le M23, lui, réclame d'abord des mesures de confiance, un cessez-le-feu, puis la signature d'un accord global.
Si les négociateurs qatariens restent mobilisés, et si la pression américaine ne faiblit pas, aucun compromis ne semble imminent.
Un cadre de surveillance diplomatique délicat
Pour garantir l'application de l'accord de Washington, deux dispositifs sont prévus : le mécanisme conjoint de coordination, et un comité de surveillance conjointe. Ce dernier aura pour tâche de recevoir les plaintes, documenter les violations et proposer des solutions. Il pourra également mettre en place des mécanismes ad hoc, en cas de besoin.
Sur le papier, l'architecture diplomatique paraît solide. Mais tout dépendra de la volonté réelle des États concernés à respecter les engagements pris. En l'absence de sanctions ou de garanties fortes, la portée de cet accord pourrait rapidement s'éroder.
rfi








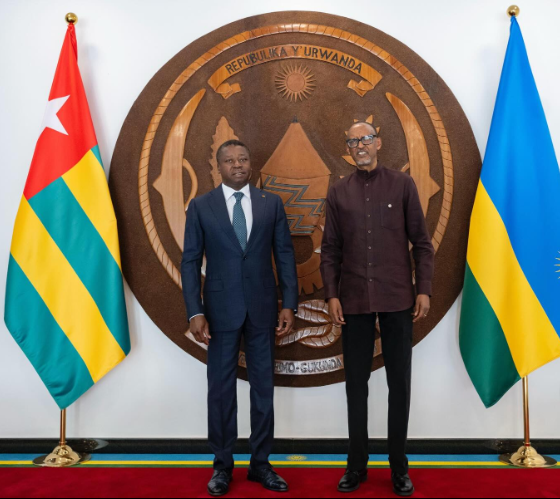



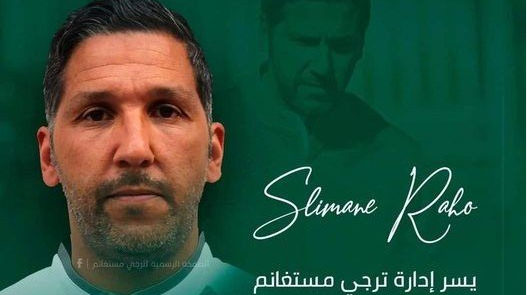

















Application de CComment' target='_blank'>CComment